La permaculture, pour aller plus loin, par Thérèse
Intervention faite par nos adhérents bénévoles
Après la conférence de samedi 5 novembre, si vous voulez développer le sujet, vous pouvez aller sur les sites suivants :
https://permacultureprinciples.com/fr
Les principes de la permaculture en français
Sur ce site vous pouvez télécharger le livre de David Holmgren
www.fermedubec.com/permaculture.aspx
C’est la ferme du Bec Hellouin
www.permaculture-sans-frontieres.org/fr/synthese-definition–permaculture
Un exemple de permaculture
www.aupetitcolibri.free.fr/Permaculture/def_perma.html
C’est le site de la ferme du Petit Colibri.
Des livres :
- Permaculture par Perrine et Charles HERVE-GRUYER chez ACTES SUD
- Le guide de la permaculture au jardin par Carine MAYO chez TERRE VIVANTE
Et un site vous donnant un large choix de livres qui développe une démarche permaculturelle :
LIVRES › Livres Jardinage Agriculture
Date : 8 novembre 2016
Photos / texte : Thérèse




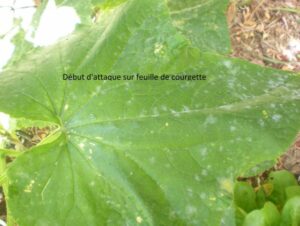





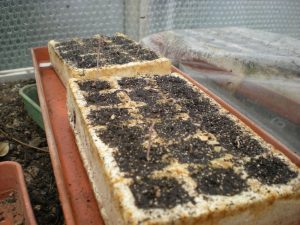






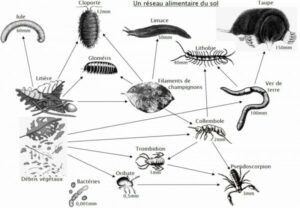

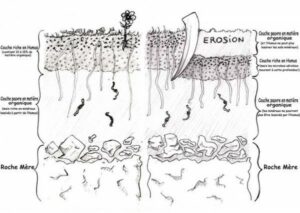

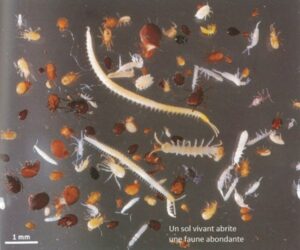
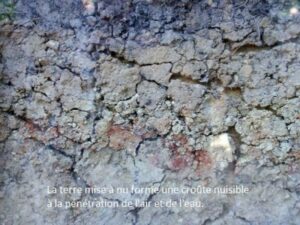





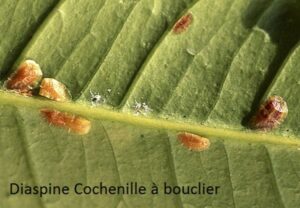
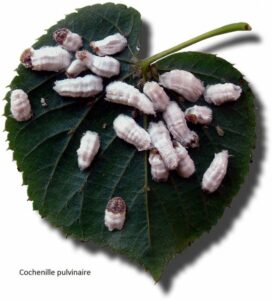

 fourmis et pucerons
fourmis et pucerons
